LES COURANTS DANS LE THÉÂTRE AVANT 1914
[Résumé écrit
d’après Le Robert des noms propres (2006), le XIXème siècle et le
XXème siècle de LAGARDE et
MICHARD (1985 pour le 1er et 1980 pour le second)]
LE NÉO-ROMANTISME depuis l’échec des Burgraves
de Victor HUGO en 1843, le romantisme semblait condamné. Il connaît
pourtant une étonnante résurrection dans les dernières années du XIXème siècle
et au début du XXème siècle, quand Edmond ROSTAND (1868~1918) fit représenter Cyrano
de Bergerac en 1897, accueilli par l’enthousiasme
du public, suivi de L’Aiglon en 1900 puis de Chantecler en 1910.
LE NATURALISME : Vers 1880,
Émile ZOLA s’attaque à ce qu’il appelle la convention, qui affadit la comédie
contemporaine : le théâtre naturaliste doit « apporter la puissance de la réalité », multiplier les scènes
qui seront « des tranches de vie »,
sans la moindre concession à la morale bourgeoise, et dans des décors
scrupuleusement documentaires. Beaucoup de romans de ZOLA, des GONCOURT, d’Alphonse
DAUDET furent adaptés à la scène, généralement sans grand succès.
La nouvelle
école adopta bruyamment un écrivain que son caractère tenait à l’écart :
Henri BECQUE (1837~1899), auteur des Corbeaux (1882) et de la
Parisienne (1885) qui sont les chefs-d’œuvre de cette forme de théâtre.
En s’attaquant
au réalisme des décors et à la vérité de l’interprétation, le Théâtre Libre, fondé par ANTOINE en 1887, assurera le triomphe éphémère du drame naturaliste.
Le réalisme
social, nuancé à la fois de cynisme et de moralisme, caractérise l’œuvre
d’Octave MIRBEAU (1850~1917). Celui-ci décrit dans Les mauvais Bergers (1896),
l’antagonisme des classes, et, dans Les Affaires sont les Affaires
(1903), il développe une description impitoyable des formes modernes du pouvoir
de l’argent.
D’autre part,
les pièces courtes et vives dans lesquelles Jules RENARD, inspiré par un
naturalisme psychologique plutôt que social, transpose, sous la forme
dramatique, son habituelle manière incisive : le pessimisme et l’amertume
se résolvent en humour et en cruauté, dans Le Plaisir de rompre (1897), Le
Pain de Ménage (1898), Monsieur Vernet (1903) et surtout
dans l’adaptation dramatique de Poil de Carotte (1900).
Émile FABRE
(1869~1953) schématise les thèses naturalistes, et en fait la matière d’un
théâtre à l’emporte-pièce, qui connut à l’époque un assez large succès bien que
sa manière manque de force proprement littéraire (L’Argent, 1895 ; Les
Ventres dorés, 1905).
LE « THÉÂTRE D’IDÉES » : Certains
dramaturges, qui font alors figure de maîtres à penser, dont l’œuvre, inspirée
par la question sociale, glisse du naturalisme aux « idées », ont eu
une influence, de valeur inégale, qui fut loin d’être négligeable.
Eugène BRIEUX
(1858~1922) écrivit des pièces à thèse qui ont connu le succès : La
Robe rouge (1900) qui pose, en termes assez énergiques, le problème de
l’administration de la justice et montre comment l’égoïsme et l’intérêt
corrompent la fonction judiciaire ; dans Les remplaçantes (1901),
il traite les thèmes de la propagande familiale, en montrant que le devoir de
la mère est d’élever personnellement ses enfants. Il était l’un des auteurs
favoris du Théâtre-libre d’Antoine.
Paul HERVIEU
(1857~1915) manifeste dans son théâtre son tempérament de moraliste dans des
drames du couple et de la famille qui abordent, avec une grande sobriété de
moyens, des problèmes sociaux (Les Tenailles, 1895, sur le
mariage ; Le Dédale, 1905, sur le divorce ; La Loi de l’homme, 1897, sur
le féminisme) ou passionnels (L’Énigme, 1901 ; La
Course au flambeau, 1901).
François de
CUREL (1854~1929) est sans doute le représentant le plus notable de ce courant.
Son théâtre d’idées a occupé une place de premier plan sur la scène française
puis sombra dans l’oubli. Son style, austère, résiste à la tentation de la rhétorique
et compense l’abstraction des idées par la puissance suggestive des images.
L’art de CUREL est de faire vivre des
personnages qui incarnent des abstractions. Le Repas du Lion (1897)
porte sur les rapports entre patrons et ouvriers ; La Nouvelle Idole (1899)
sans doute son chef-d’œuvre, soulève le problème des limites morales du pouvoir
scientifique. Après la seconde guerre mondiale, Terre inhumaine (1922)
aborde le thème de l’amour entre un homme et une femme appartenant à des
nations ennemies.
LE THÉÂTRE D’AMOUR : La psychologie
amoureuse reste le thème de prédilection de nombre d’auteurs à la mode.
Henry BATAILLE
(1872~1922) représente le mieux le caractère déjà conventionnel du « théâtre de boulevard » où le sujet
des pièces à succès est le conflit entre la passion et les obstacles qu’elle
rencontre. Son théâtre propose la peinture complaisante de mœurs décadentes
dans un style que l’on a appelé « le
réalisme sentimental » (Maman Colibri, 1904 ; La
Marche nuptiale, 1905 ; La Femme nue, 1908 ; La
Vierge folle, 1910 ; L’Homme à la rose, 1920).
Henry BERNSTEIN
(1876~1953) décrit les mœurs d’une société où l’argent et la vie sensuelle
constituent d’essentielles raisons de vivre. Il transforme la scène en un champ
clos où se heurtent passions, intérêts et valeurs morales. C’est un des maîtres
de ce qui s’appellera le « suspens »
dramatique. Sa psychologie reste conventionnelle et n’échappe pas au risque de
la vulgarité. Le succès de son théâtre
fut considérable jusqu’aux années de l’après-guerre 1939 (La Rafale, 1905 ; La
Griffe, 1906 ; Le Voleur, 1906 ; Samson,
1907 ; Le Secret, 1913 ; Félix, 1926 ; Mélo,
1929 ; La Soif, 1949).
Georges de
PORTO-RICHE (1849~1930) conçoit le théâtre comme une anatomie sentimentale dont il dresse les résultats dans son
« Théâtre d’amour » qui a
pour thème dominant la passion sensuelle, avec les obsessions, les épreuves et les
déchéances qu’elle entraîne pour ses victimes (Amoureuse, 1891 ; Le
Passé, 1997 ; Le Viel Homme, 1911 ; Le
Marchand d’Estampes, 1917).
LE THÉÂTRE DU BOULEVARD : Le
public a apprécié particulièrement, parmi les nombreux auteurs du boulevard,
quatre écrivains de talent qui ont produit une vingtaine de pièces chacun entre
1895 et 1914.
Maurice DONNAY (1859~1945) :
fit ses débuts au Chat-noir dont la verve légère qui l’anima se retrouve
souvent dans son théâtre (Lysistrata, 1892 ; Éducation
du prince, 1900) mais qui prend parfois les couleurs plus sombres du
drame (Amants ,1895 ; La Douloureuse ; Le
Torrent ; L’Autre Danger, 1902 ; Le
Retour de Jérusalem, 1904 ; Paraître, 1906 ; Les
Éclaireuses.
Alfred CAPUS
(1858~1922) : Les Petites Folles, La Veine, La Petite Fonctionnaire, Notre
Jeunesse, Un Ange.
Henri LAVEDAN
(1858~1940) a été le peintre complaisant de la société parisienne de son temps : Le
Vieux Marcheur, 1899 ; Viveurs ; Le Marquis de Priola,
1902 ; Le Duel, 1905 ; Servir.
Abel HERMANT
(1862~1950) : Monsieur de Courpière, Rue de la Paix, La Belle Madame Hébert, Trains
de Luxe, Les Transatlantiques, pièce conçue avec des couplets dus à la
collaboration avec Franc-Nohain qui en font presqu’une opérette.
LE VAUDEVILLE ET LA COMÉDIE LÉGÈRE :
Georges FEYDEAU
(1862~1921) fut, après LABICHE, le maître du vaudeville. Il porta ce genre
mineur à son point de perfection, avec 39 pièces, comédies en trois actes.
Entre la farce et la comédie, son théâtre est un perpétuel jaillissement de
situations cocasses, de péripéties tumultueuses et absurdes où se trouvent
engagés des personnages dénués de réalité et cependant rigoureusement fidèles,
dans leur inconséquence, aux modèles proposés. Une logique rigoureuse,
renouvelée par le sens de l’inattendu, et la vivacité d’un mouvement
vertigineux font la valeur durable de ce théâtre. On peut citer Monsieur
chasse (1892), Un Fil à la patte (1894), L’Hôtel
du Libre Échange (1894), Le Dindon (1896), La
Dame de chez Maxim (1899), Occupe-toi d’Amélie (1908), Mais
n’te promène pas toute nue (1912), pièces qui sont encore souvent à
l’affiche de nos jours.
Tristan BERNARD
(1866~1947), romancier et auteur dramatique, fut surtout un humoriste dont on cite quantité de bons
mots. C’est l’humour qui fait le charme de ses romans comme de ses pièces en un
trois ou cinq actes depuis Les Pieds nickelés (1895)
jusqu’à Jules, Juliette et Julien
(1929). L’Anglais tel qu’on le parle est un court vaudeville qui est
resté au répertoire. L’Étrangleuse (1908) est une parodie
tragi-comique. Les Jumeaux de Brighton est une amusante reprise du
thème des Ménechmes[1]. Monsieur
Codomat (1907) est une comédie de caractère. Triplepatte (1905) écrite
en collaboration avec André
GODFERNAUX est une comédie de l’indécision qui unit l’esprit, la fantaisie et la satire légère à une sympathie compréhensive, presque
attendrie.
Robert de FLERS
(1872~1927) et Gaston Arman de CAILLAVET (1869~1915) inaugurent avec le siècle
une collaboration féconde. Ils trouvent leur voie dans la satire des mœurs tout en demeurant indulgents et en émoussant
les traits de « rosserie » par une amabilité mondaine et un ton de
bonne compagnie : Le Roi (1908), L’Habit vert (1912), La
Belle Aventure (1913). Après la mort prématurée de CAILLAVET, de FLERS
collabora avec Francis de CROISSET (1877~1937) pour Les Vignes du Seigneur (1923)
et le livret de l’opérette Ciboulette (1923).
Georges
COURTELINE (1858~1929) stigmatisa
avec drôlerie la bêtise, sous toutes ses formes. Il évoqua la vie militaire
dans Les
Gaieté de l’escadron (1886), Le Train de 8 heures 47 (1888) et Lidoire,
tableau militaire (1891). Il fit souvent s’affronter le citoyen-victime
à la tyrannie des lois et des magistrats qui les servent : Un
Client sérieux (1896), Le commissaire est bon enfant et Le
Gendarme est sans pitié (1899). Il fait la satire des petits
fonctionnaires peignant avec une verve
comique, et parfois amère, le médiocre despotisme de ces derniers, serviteurs
et esclaves d’un règlement absurde : La Lettre chargée (1897). Il montre dans
L’Article
333 (1900) et Les Balances (1901) combien il est
difficile d’innocenter un homme qui n’a rien fait. Dans la nouvelle adaptée
pour le théâtre et montée par Antoine, Boubouroche (1903), il reprend la
satire traditionnelle de la femme volage qui bafoue impudemment un mari pleutre
et bon et témoigne de sa verve. La Paix chez soi (1903) et La
Peur des coups (1894) connurent aussi un grand succès.
[1] Les Menechmes : Comédie de
Plaute (v. -254~-184), imitée de Ménandre-v. -342~v. -292), contemporain et ami
d’Épicure, auteur de comédies. L’un des deux fils jumeaux d’un marchand
sicilien a été enlevé. Devenu homme, l’autre part à la recherche de son frère
et le retrouve en Épire où celui-ci a fait fortune. Mais la ressemblance entre
les deux frères est si grande que chacun, femme, maîtresse et beau-père s’y
laisse prendre. Cette confusion engendre une suite de quiproquos et d’incidents
comiques à la suite desquels les deux frères se reconnaissent.

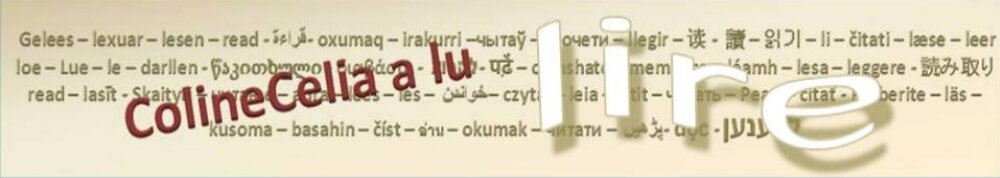
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F38%2F726986%2F98008862_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F18%2F16%2F726986%2F79208401_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F82%2F726986%2F77605698_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F99%2F726986%2F79191433_o.jpg)